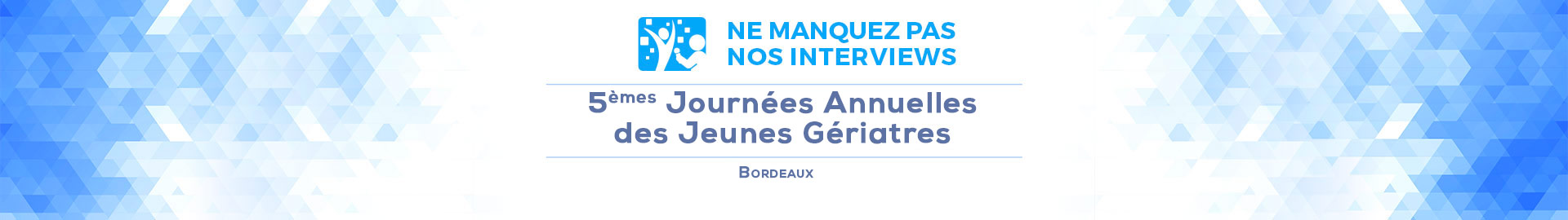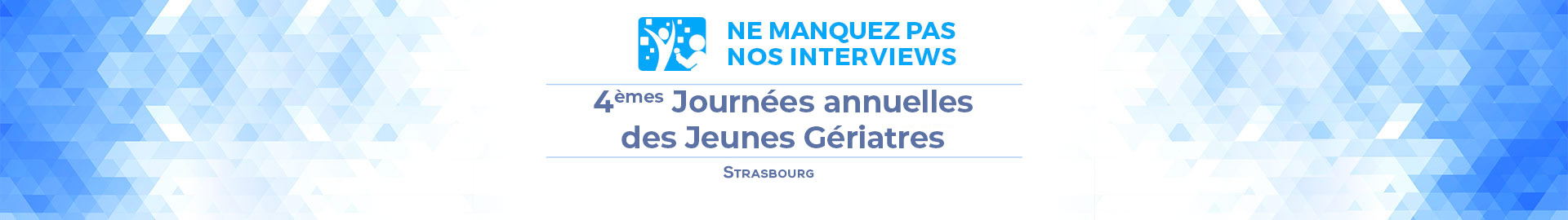Recherche
L’agence européenne des médicaments autorise le médicament anti-Alzheimer Lecanemab sous conditions
Après un premier avis négatif en juillet 2024, l’Agence européenne des médicaments (EMA) recommande en novembre 2024 la mise sur le marché du Lecanemab, commercialisée par les laboratoires Eisai et Biogen sous le nom Leqembi. L’autorisation est toutefois restreinte pour limiter les risques d’effets secondaires identifiés.
Ce médicament, tout comme le donanemab, est un anticorps monoclonal qui s’adresse aux personnes ayant la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. Il est administré par perfusion et cible les plaques amyloïdes.
L’EMA restreint toutefois cette autorisation aux patients qui n’ont qu’une seule copie ou aucune copie du gène ApoE4, soit les moins susceptibles de présenter des effets secondaires graves de type anomalies d’imagerie liés à l’amyloïde (ARIA). L’EMA précise que l’administration du traitement se fera sous contrôle médical strict d’un personnel qualifié, avec un accès régulier à l’imagerie de type IRM. L’objectif est de garantir la sécurité du traitement, en vérifiant l’absence de complication liée à son administration. Deux études sont également demandées : l’une pour mesurer la sécurité postautorisation et caractériser plus en détail les effets secondaires et l’autre pour la mise en place d’un registre à l’échelle de l’Union européenne, qui pourra être utilisé pour estimer l’incidence de ces effets et leur gravité.
L’Agence européenne signale en outre avoir pris en compte, pour rendre son avis, les soumissions des patients, soignants, cliniciens et organisations, qui ont notamment mis en lumière les besoins non satisfaits des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
Santi P. Alzheimer : l’Agence européenne des médicaments approuve un traitement réservé à certains patients. Le Monde. 2024 Nov 15.
Chauvot M. Alzheimer : l’Europe ouvre la porte à un nouveau traitement. Les Échos. 2024 Nov 15.
Hospimedia. L’agence européenne autorise le médicament anti-Alzheimer lecanemab sous conditions. 2024 Nov 15.
Recherche
La fragilité chez les 50 ans et plus en France et en Europe : deux décennies d’évolution et d’inégalités à partir des données de l’enquête SHARE
L’enquête européenne sur le vieillissement SHARE est mobilisée ici pour mesurer la fragilité chez les plus de 50 ans (selon la définition de Linda Fried). Le phénotype de fragilité proposé par Fried et al. (2001) repose sur une conception de la fragilité comme dégradation de cinq attributs fonctionnels de référence (énergie, mobilité, activité physique, poids, force musculaire). L’enquête SHARE fournit des données longitudinales fiables collectées depuis 2003 dans 27 pays européens.
Sur l’ensemble de la période, la fragilité est rare avant 75 ans, mais concerne, en moyenne, plus d’une personne sur quatre après 75 ans. Elle est plus fréquente chez les femmes, avec un surcroît de fragilité de 4 à 7 % selon la période. L’analyse fait apparaître de claires inégalités sociales de fragilité, plus marquées chez les femmes. Ainsi, chez les Européennes de 75 ans et plus, ne pas avoir fait d’études au-delà du deuxième cycle ou déclarer des difficultés à équilibrer son budget est associés à des niveaux de fragilité supérieurs de 17 %.
L’ampleur des inégalités sociales s’est légèrement accrue chez les hommes et a fluctué selon la période, la catégorie d’âge ou le pays chez les femmes. Ces inégalités semblent toutefois s’accroître au-delà de 75 ans chez les femmes dans la plupart des pays d’Europe au cours des dernières années, y compris depuis la pandémie de COVID-19.
Ce constat appelle à considérer la dimension d’équité sociale dans les politiques de dépistage et de prévention de la fragilité mises en œuvre aussi bien que dans l’accès aux dispositifs d’aide et de soins.
Arnault L, Jusot F, Renaud T. La fragilité chez les 50 ans et plus en France et en Europe. Deux décennies d’évolution et d’inégalités à partir des données de l’enquête SHARE. 2024. https://univ-paris-dauphine.hal.science/DNSS/hal-04701334v1