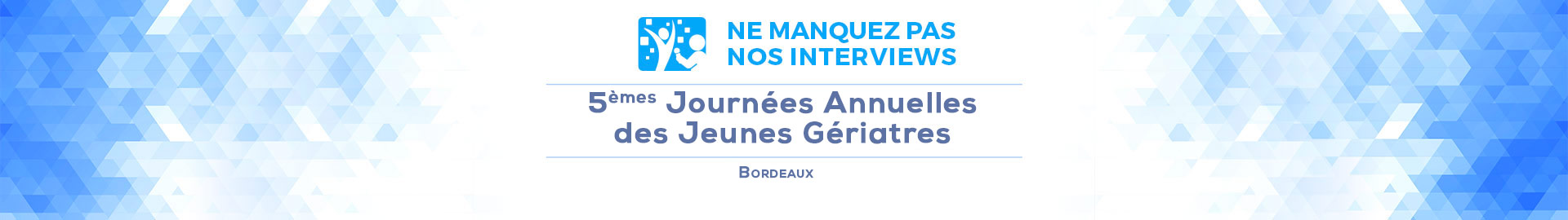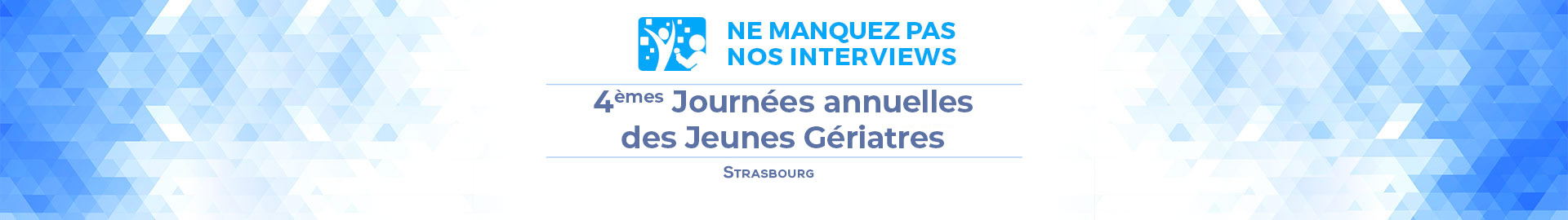L orsque Peter Millard (1937-2018) inaugurait son cours annuel de gériatrie aux étudiants en médecine du Saint George’s Hospital de Londres, il dessinait d’emblée à la craie sur le tableau noir de l’amphithéâtre une petite chaise, une grande chaise et une chaise moyenne et commençait par ces mots : « Voici la salle d’attente du gériatre. » Il ajoutait : « Les aînés sont si différents les uns des autres que par comparaison, tous les bébés sont identiques. » Surprise et succès garantis. L’attention captée des étudiants leur permettait d’entrée d’intégrer l’extrême diversité des « personnes âgées » comme une donnée fondamentale de la gérontologie et de la gériatrie. Ce qui n’était pas évident pour des étudiants confrontés à leurs premiers stages, notamment aux urgences hospitalières où les malades vieilles et vieux étaient à l’époque victimes d’âgisme, de préjugés négatifs et globalisants au seul énoncé de leur âge chronologique, et de conduites à tenir médicales discriminantes.
À l’instar de la biodiversité des écologistes ou de la neuro-diversité des psychologues de l’autisme, la gérodiversité mérite un terme spécifique pour un concept qui peut être considéré à notre époque de grandes transitions humaines comme un atout positif représentant la réalité.
En gérontologie, les besoins et les solutions sont toujours multiples, rappelait Robert Hugonot (1922-2010). Comme les personnes, les besoins en gérontologie sont notamment d’une grande diversité tout comme leurs fondements multiples, bio, psycho, sociaux.
La gérodiversité recouvre ainsi les vastes champs du constat individuel, de l’atout collectif, ou encore de l’outil préventif :
• habitat, quartier, revenus, inclusion, accès aux aides et aux services ;
• santé et fonctionnalité, habitudes alimentaires, activité physique ;
• niveau d’études, centres d’intérêt, culture, vie artistique, créativité ;
• implication familiale, intergénérationnelle et sociale ;
• compétence cognitive et équilibre thymique.
À titre individuel, nos concitoyens aînés sont toutes et tous extrêmement différents bien qu’éthiquement uniques…
Richesse de la vie collective spontanée ou imposée, la diversité des caractères, des compétences, des intérêts dynamise la vie d’une famille petite ou grande, les groupes culturels, les chorales, les universités populaires, les groupes de théâtre, de marche, de botanique ou de géologie, les sorties culturelles ou les voyages, l’engagement bénévole, associatif ou public, la vie affective ou amoureuse, l’entraide inter- et intragénérationnelle pour les plus fragiles, et même une vie professionnelle longue par choix ou obligation.
À titre collectif, la gérodiversité enrichit la société.
Clé de voûte du bien-vieillir, la gérodiversité mérite d’être enseignée comme une dimension fondamentale de la gérontologie, et d’être incluse dans tous les projets structurels et fonctionnels. De la ville amie des aînés à la vie de quartier, de la création d’une résidence au tiers lieu créatif et à la modernisation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), du virage domiciliaire multiforme jusqu’à l’aide aux aidants, la prise en compte de la gérodiversité introduit l’humanité et crée la qualité.
À l’échelle sociale, la gérodiversité oblige à l’adaptation, et incite à la personnalisation attentive des aides et des soins.
Pourtant, prôner la richesse de la diversité ne va pas de soi pour nos générations formées au normatif, au sérieux des statistiques, de la loi normale de Gauss, du standard. Peut-être, nous les gérontologues et les gériatres, aurions-nous dû réagir un peu plus tôt et un peu plus fort aux diktats des études de médicaments qui éliminent les plus vieilles et les plus vieux citoyens des études au motif qu’ils ne rentrent pas dans la norme ? Peut-être, au-delà des études dites « qualitatives », aurions-nous dû renforcer plus tôt les méthodologies de recherche pour les petits effectifs qui sont la règle en gérontologie, et notamment en gérontechnologie ?
La gérodiversité n’a pas encore livré tous ses secrets et sans doute sera-t-elle un puissant moteur d’innovation en méthodologie de la recherche clinique… si, à la tâche, les plus jeunes d’entre nous le veulent bien.n
Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt en rapport avec cet article.